Temps de lecture estimé : 14 minutes
(Attention, beaucoup de passages sont en anglais)
Hé. Revenez ! Je sais que ça a l’air chiant comme la mort, mais ne partez pas. Imaginez plutôt. Nous sommes en 1894, et l’amour est un sujet qui a déjà été très (trop) souvent exploité en littérature. De grand-es auteurices nous ont laissé des œuvres intemporelles (c’est à dire : trop datées pour qu’on puisse encore les lire confortablement), et parfois obligatoires au programme scolaire : Jane Austen bien entendu, mais aussi Charlotte Brontë, Nathaniel Hawthorne ou encore Gustave Flaubert pour un nom bien d’cheu nous. On pourrait se dire qu’on a fait le tour de la question.
Peut-être que ces noms vous provoquent des cauchemars, peut-être que vous avez adoré les lire, ici on ne juge pas car on a lu (volontairement) tout Hawthorne en VO, donc bon. Chacun-e ses névroses.
Quoi qu’il en soit, on peut s’entendre sur certaines caractéristiques de ces textes : l’amour est toujours l’Amour, avec sa majuscule, grandiloquent, excessif, absolu. Ce n’est pas un sujet de plaisanterie, plutôt une raison de perdre la vie. Les histoires sont épiques, mystérieuses, tragiques, passionnelles jusqu’à l’excès et, souvent, oui souvent, un peu chiantes. Personne ne vit sa vie comme ça, au bout d’un moment. Au quotidien, ce type de romantisme tragique est un peu trop lourd à porter. Qui s’est déjà jeté aux pieds de l’être aimé en l’implorant, des sanglots dans la voix : « Ho, lumière de mes jours et douceur de mes nuits, que deviendrai-je si tu ne me passe pas le sel ? ». Vous imaginez ? Surtout si la réponse est « Bah, heu, tiens. » Un coup dur.
Alors oui, en 1894 on est plutôt sur la fin du mouvement romantique en tant que tel. C’est peut-être pour ça, ou peut-être pas, je ne me suis pas interrogée sur les raisons, que Jerome K. Jerome décide d’écrire une nouvelle romantique. Pas un roman, pas une épopée, juste une courte nouvelle, du nom de « John Ingerfield », lisible au début du recueil de nouvelles « John Ingerfield and other stories ». Auteur généralement connu pour son humour (ce qu’il déplore, mais toujours avec humour, au début du recueil en question), il dévie alors de son style habituel pour nous proposer une étrange histoire.
Celle de John Ingerfield, un homme de son temps, qui s’est « fait tout seul » en exploitant les besoin en énergie d’une Angleterre en pleine industrialisation. Un capitaliste, quoi. Arrive le jour où il considère que l’étape suivante dans le plan de carrière de sa vie est de trouver une épouse, et bien entendu une épouse d’origine aristocratique (afin de lui ouvrir les portes de la noblesse, fermées pour un nouveau riche tel que lui), et l’article (car tel est le terme employé par ce brave John) doit être « young and handsome, fit to grace the fine house he will take for her in fashionable Bloomsbury[…]. She must be well bred, with a gracious, noble manner, that will charm his guests and reflect honour and credit upon himself; she must, above all, be of good family, with a genealogical tree sufficiently umbrageous to hide Lavender Wharf from the eyes of Society. What else she may or may not be he does not very much care. She will, of course, be virtuous and moderately pious, as it is fit and proper that women should be. It will also be well that her disposition be gentle and yielding, but that is of minor importance, at all events so far as he is concerned: the Ingerfield husbands are not the class of men upon whom wives vent their tempers. »
Tout un programme.
Notre homme va user de son influence (et, surtout, de menaces sur un de ses débiteurs) pour trouver la perle rare. Miracle, elle existe, et elle n’attend pas grand chose d’un mari. En effet, « she’s a sensible girl, no confounded nonsense about her, and the family are poor as church mice. In fact—well, to tell the truth, we have become most excellent friends, and she told me herself frankly that she meant to marry a rich man, and didn’t much care whom. » Là encore, on est loin de l’idéal d’un mariage d’amour. D’un autre côté, pour accepter d’épouser John, il ne fallait pas avoir de très hautes attentes.
Leur première rencontre se terminera d’ailleurs par l’échange suivant :
“Ours will be a union founded on good sense,” said John Ingerfield.
“Let us hope the experiment will succeed,” said Anne Singleton.
Pragmatique, sobre, un arrangement idéal.
Bien évidemment, une union de ce genre n’apporte pas vraiment de chaleur dans le foyer, et si chacun-e remplit parfaitement les obligations liées à son rôle, aucun-e n’évolue vraiment ni ne cherche à découvrir l’autre. Jusqu’au jour où une épidémie de typhus se déclare, et que notre brave John va enjoindre son épouse Anne à partir quelques temps pour éviter la maladie, tandis que lui retourne à son usine pour aider « ses » gens. Bien évidemment, Anne ne l’entend pas de cette oreille et a très envie d’aider, elle aussi, si bien que notre étrange couple commence à organiser un hôpital de fortune et s’occuper des malades.
Je m’arrête là pour ce résumé, parce qu’il est parfaitement tel qu’il doit être : à priori chiant et classique (même si j’aime beaucoup l’excès de froideur dans la description de chacun des protagonistes, un excès presque comique).
SAUF QUE ! Vous ne pensez pas que je vais vous laisser comme ça, allons. Car c’est là que l’histoire devient intéressante. L’éclosion des sentiments, vécue par chacun-e dans son for intérieur, la gaité qui l’accompagne, les idées étranges que cela fait naître (par exemple, John prend conscience qu’il aime quand sa femme l’envoie faire une course, lui qui n’a jamais pris d’ordre de personne, et ne comprend pas d’où lui vient son étrange sentiment de fierté lorsqu’il mène sa mission à bien)… Pendant longtemps, aucun-e ne sera capable d’exprimer ce changement, l’habitude est trop ancrée de se comporter froidement l’un-e avec l’autre ! Jusqu’à une scène incroyable dans sa simplicité où iels vont vouloir faire la cuisine en pleine nuit.
« John accepts the challenge, and, guiding Anne with one shy, awkward hand, while holding aloft a candle in the other, leads the way. It is past ten o’clock, and the old housekeeper is in bed. At each creaking stair they pause, to listen if the noise has awakened her; then, finding all silent, creep forward again, with suppressed laughter, wondering with alarm, half feigned, half real, what the prim, methodical dame would say were she to come down and catch them.
They reach the kitchen, thanks more to the suggestions of a friendly cat than to John’s acquaintanceship with the geography of his own house; and Anne rakes together the fire and clears the table for her work. What possible use John is to her—what need there was for her stipulating that he should accompany her, Anne might find it difficult, if examined, to explain satisfactorily. As for his “finding the things” for her, he has not the faintest notion where they are, and possesses no natural aptitude for discovery. Told to find flour, he industriously searches for it in the dresser drawers; sent for the rolling-pin—the nature and characteristics of rolling-pins being described to him for his guidance—he returns, after a prolonged absence, with the copper stick. Anne laughs at him; but really it would seem as though she herself were almost as stupid, for not until her hands are covered with flour does it occur to her that she has not taken that preliminary step in all cooking operations of rolling up her sleeves.
She holds out her arms to John, first one and then the other, asking him sweetly if he minds doing it for her. John is very slow and clumsy, but Anne stands very patient. Inch by inch he peels the black sleeve from the white round arm. Hundreds of times must he have seen those fair arms, bare to the shoulder, sparkling with jewels; but never before has he seen their wondrous beauty. He longs to clasp them round his neck, yet is fearful lest his trembling fingers touching them as he performs his tantalising task may offend her. Anne thanks him, and apologises for having given him so much trouble, and he murmurs some meaningless reply, and stands foolishly silent, watching her. »
N’est-ce pas tout mignon ? J’ai coupé avant que ça dégénère dans la farine, bien entendu. On dirait presque une romcom récente, en fait. On est loin de La Fâmme dans son rôle de déesse d’albâtre mais sans autre but que l’amour et le mariage, et de l’homme infaillible de virilité (tout en exprimant une certaine fragilité), communs à l’époque. J’ai trouvé cette nouvelle curieusement avant-gardiste pour son temps, et adoré le traitement des personnages. Du côté de John, on démarre avec un homme focalisé uniquement sur sa réussite et qui a une vision de l’autre strictement utilitaire. Du côté de Anne, sa froideur lui vient d’une relation passée et d’une trahison pour des raisons bassement matérielles, elle n’attend donc plus rien des hommes. Et soudain, les deux vont découvrir leur amour non comme une explosion de passion brutale, mais grâce à la construction d’une tendresse mutuelle née d’une volonté commune de se rendre utile aux autres. Il s’exprimera au travers de nombreuses maladresses, de façon très naturelle, et c’est ce qui m’a fait accrocher à ce point à cette nouvelle. C’est un peu drôle, attendrissant, sobre et, bien évidemment, terriblement triste. Mais là encore, une tristesse contenue, évoquée avec distance en trois petites phrases, les dernières de la nouvelle que je ne vous citerai pas. Les lire seules n’aurait aucun intérêt, elles doivent venir à vous à ce moment précis de l’histoire, c’est tout. Et c’est très beau.
Si vous avez quelques minutes à perdre, la nouvelle est lisible gratuitement ici : John Ingerfield and Other Stories, sur Gutenberg.org.
Pour terminer, petite parenthèse sur Jerome K. Jerome : l’homme n’était pas connu pour ses positions éminemment féministes, de manière générale. Éditeur de deux journaux (« The idler » et « Today ») , il y a longuement étalé ses idées contre les mouvements d’émancipations des femmes, souvent avec humour mais également avec une certaine ténacité. Et même si il défendait l’accès à certains droits pour les femmes (comme celui de faire du vélo ou de fumer), le blocage survenait lorsqu’il était question de sexualité. Pour lui, cela ne concernait pas les femmes (à se demander avec qui ces grands messieurs couchaient, vu leur dégout pour les rapports homosexuels), et notre éducation sexuelle ne pouvait que mener à la débauche. Bon ok, il a été élevé dans la religion, donc on peut y trouver un début d’explication (mais pas une excuse. Un homme éduqué comme lui aurait dû être capable de réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez.) Il a également eu longtemps une vision très négative des autrices, ce qu’on retrouve dans plusieurs de ses textes, avant de bouger un peu sur cette question.
Il reste pourtant un de mes auteurs favoris, même si je grince parfois des dents devant certains textes, car la Femme est un être de contradictions et, bien évidemment, irrationnel. (/s)
Plus sérieusement, il est étonnant de découvrir, dans cette nouvelle, une vision des femmes justement étonnamment peu sexiste : le personnage a une motivation personnelle claire, elle tient son rôle d’épouse parfaite mais on ne parle pas du plaisir qu’elle y prend, on dirait plutôt qu’elle le fait car elle a été éduquée pour ça, point. D’ailleurs elle s’en échappe dès que l’occasion se présente, aussi dramatique soit-elle. Il n’y a également pas de jugement particulier posé sur son histoire, le fait qu’elle ait été trahie par un amant inconséquent est clairement montré comme quelque chose de cruel, et cet échec ne lui est pas reproché à elle. Il n’y a pas non plus de jugement sur le fait que cette relation ait existé, bien qu’elle n’ait pas débouché sur un mariage. On échappe aussi à la pâmoison et autres démonstrations de passion exagérées lorsqu’elle se découvre amoureuse : son comportement ne change pas, elle aussi est maladroite que John et ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de ses nouveaux sentiments. J’étais même très étonnée, connaissant les positions de JKJ sur les mouvements d’émancipation des femmes, de le voir dépeindre une femme qui est presque un miroir de son personnage masculin : il ne la rabaisse à aucun moment. Je ne dis pas que le texte est parfait, mais considérant l’époque et l’auteur, je reste étonnée du fait que je n’ai pas vraiment eu envie de râler en le lisant.
Il est également à porter au crédit de JKJ certaines remarques étranges. Par exemple, il a parfois ironisé sur la vanité des femmes en la comparant à celle des hommes, pour arriver à retourner parfaitement la critique et l’appliquer justement davantage aux hommes. De la même façon, il a aussi jugé les mouvements féministes naissants assez cruellement tout en étant capable de remarquer que les femmes étaient tout de même maltraitées par la « société actuelle ». Je pense que son point de vue était alors que si les femmes étaient « bien traitées » (comme on traite bien les chiens), alors elles n’auraient aucune envie de s’émanciper. Mais bon, ce n’est qu’une interprétation.
Notons aussi qu’il a écrit deux livres sur des femmes journalistes. Si le premier (Tommy&Co) est une comédie jouant beaucoup sur les stéréotypes (de genre et de race, Tommy étant en plus une « bohémienne »), l’autre (All roads lead to Calvary) est un long texte sérieux et un peu chiant mais également un curieux mélange de paradoxes où il se débat entre ses idées et le fait que son personnage semble lui échapper et se tourner d’elle-même vers le suffragisme. Ce livre, un mélange de réflexion religieuse et sociale, est presque un brainstorming à ciel ouvert, mais qui montre qu’une fois loin de son journal où il tient ses positions clairement, il a du mal à les justifier à force de réflexion et d’empathie avec son personnage.
Notons enfin que quelques mois avant sa mort, en 1926, il écrit (dans « My life and times ») : « I wrote « The MacHaggis » in collaboration with Eden Phillpotts. Penley accepted it, but fell ill, and handed the part over to Weedon Grossmith. Our heroine shocked the critics. She rode a bicycle. It was unwomanly, then, to ride a bicycle. There were so many things, in those days, that were unwomanly to do. It must have been quite difficult to be a woman, and remain so day after day. She smoked a cigarette. The Devil must have been in us. Up till then, only the adventuress had ever smoked a cigarette. In the last act, she said « damn. » She said it twice. Poor Clement Scott nearly fell out of The Daily Telegraph. »
Je ne cherche pas à le défendre, notez bien. Le type est mort depuis bien longtemps et n’a pas besoin de moi. Mais je porte avec moi cette impression que ses idées n’étaient pas aussi arrêtées que celles d’autre de ses contemporains. Et il n’aimait pas la chasse à courre, ce qui augmente son potentiel sympathique (« Riding to hounds would be good sport, if it were not for the fox. So long as the gallant little fellow is running for his life, excitement, one may hope, deadens his fear and pain. But the digging him out is cold-blooded cruelty. He ought to have his chance. How men and women, calling themselves sportsmen, can defend the custom passes my understanding. It is not clean. »)
Si vous voulez en savoir plus, un article complet sur le sujet (mais que je trouve un peu partial) (DIT-ELLE, totalement non biaisée et parfaitement objective en tout point) : « ‘a pot of ink that she would come to hate the smell of’: Banishing the Beast in Jerome K. Jerome’s New Woman
Journalists », sur JSTOR
Vous pouvez aussi lire « My Life and Times » sur le site gutenberg.ca (aucune idée de pourquoi il n’est pas sur le .org, sans doute une question de copyright). Par contre c’est un peu confus et bordélique, rien de très intéressant d’un point de vue littéraire si vous voulez mon avis. Des faits, des dates, bon.
Désolée pour ce qui est devenu une longue parenthèse, j’espère que c’était au moins un peu intéressant !
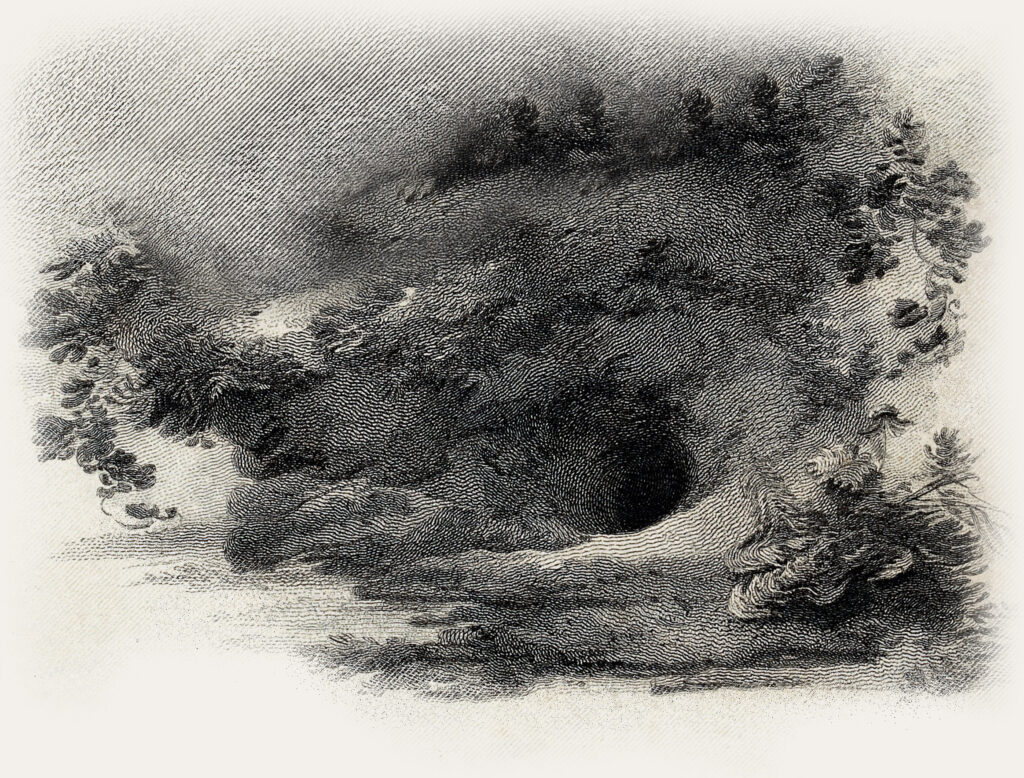
Laisser un commentaire